Un mois avant l’assassinat de Carlo Rosselli en France (lire notre épisode précédent [1]), un de ses amis a, lui aussi, disparu dans des conditions tragiques. Si c’est le régime fasciste de Mussolini qui a armé le bras des tueurs dans le premier cas, c’est l’ombre de Staline qui plane sur l’élimination du second.
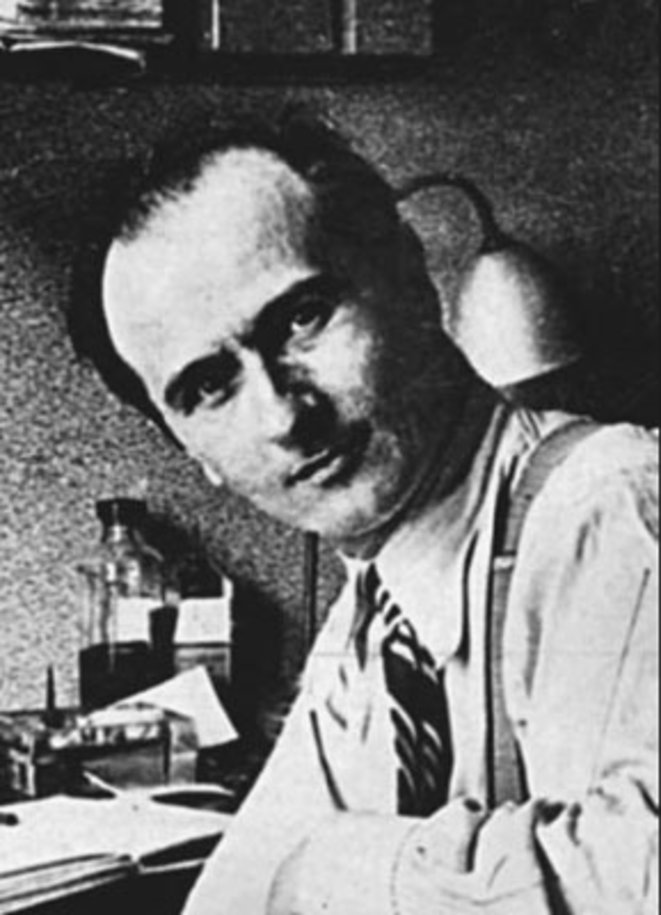
Camillo Berneri © Wiki Commons
Tout n’est pas connu des causes ayant abouti à l’assassinat de Camillo Berneri, à Barcelone, le 5 mai 1937. Mais avant que son cadavre et celui de son camarade Ciccio Barbieri ne soient trouvés dans la rue, les deux Italiens ont été arrêtés par des policiers et des miliciens très reconnaissables du PSUC, le parti catalan fédéré avec le Parti communiste espagnol et affilié à l’Internationale communiste bâtie par les Soviétiques. Le contexte a son importance, car ces journées de mai sont celles durant lesquelles un affrontement a eu lieu entre les forces soutenant le retour à la légalité républicaine en Catalogne (dont les communistes) et les forces soutenant le processus révolutionnaire lancé par les organisations ouvrières de la région, parmi lesquelles les anarcho-syndicalistes de la CNT-FAI et les marxistes indépendants du Poum.
C’est pourquoi l’historien Miguel Chueca [2] estime que l’assassinat des deux hommes est le fruit d’un « Thermidor stalino-républicain », dont ni les auteurs ni les commanditaires ne seront jamais inquiétés. Un mois auparavant, Berneri avait écrit une lettre à Federica Montseny [3], qui faisait partie des quatre ministres anarchistes ayant accepté d’intégrer le gouvernement d’unité de Largo Caballero. Il y protestait contre la domestication des organes de pouvoir populaire et des milices ouvrières, qui étaient nés du soulèvement contre le pronunciamiento de 1936, aussi bien que du vide initialement laissé par l’État républicain.
« Il va de soi que lorsque pendant des mois on cherche à annihiler les “incontrôlables”, on ne peut résoudre le problème de la liquidation de la “Cinquième colonne”, argumentait-il. […] Une politique intérieure de collaboration entre les classes et de flatterie envers les classes moyennes conduit inévitablement à la tolérance envers les éléments politiquement équivoques. » Là où les autorités légales et les soutiens soviétiques entendaient donner la priorité à l’organisation efficace du combat militaire sur la révolution sociale, Berneri répondait : « Le dilemme “guerre ou révolution” n’a plus de sens. Le seul dilemme est celui-ci : ou la victoire sur Franco grâce à la guerre révolutionnaire, ou la défaite. Le problème pour toi et pour les autres camarades est de choisir entre le Versailles de Thiers et le Paris de la Commune, avant que Thiers et Bismarck ne fassent l’union sacrée. »
Comme le socialiste Rosselli, l’anarchiste Berneri a accouru en Espagne dès les débuts de la guerre civile, à la fin juillet 1936. Il se rapproche de la CNT avec d’autres libertaires italiens et contribue à monter une section de combat aux côtés de son compatriote Rosselli, au sein de la colonne Ascaso. À partir du mois d’octobre, il lance également un journal entièrement écrit en italien, Guerra di Classe, dans lequel il met en garde contre la « normalisation » à l’œuvre dans le camp antifasciste, puis contre la « contre-révolution » interne qui s’annonce au nom des impératifs militaires.
Avant d’être une victime des règlements de comptes internes au camp républicain sur le front espagnol, Berneri aura résidé dans de nombreux autres pays. En avril 1926, il a, en effet, choisi l’exil en France, après avoir subi des agressions et des brimades professionnelles. En cause, son engagement anarchiste embrassé dès 1915, à l’âge de 18 ans. Ses ennuis judiciaires, liés aux accusations de complot que lui vaut son activisme antifasciste, l’ont contraint à être ballotté entre France, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Il en retira le qualificatif d’« anarchiste le plus expulsé d’Europe ».
Une affaire en particulier lui a causé du tort : le piège que lui a tendu un certain Menapace, un agent fasciste qui l’a manipulé. Si l’homme n’a pas réussi à neutraliser complètement le militant anarchiste, il lui a fait perdre beaucoup de crédit auprès de l’ensemble des milieux antifascistes. Ce cas précis nous rappelle une autre constante dont Berneri a été la victime : sa surveillance par le régime de Mussolini depuis les débuts jusqu’au terme de sa vie militante. Auteur d’une thèse sur le personnage, le chercheur Giovanni Stiffoni relève d’ailleurs que « la plupart des informations dont on dispose à propos de la vie de Camillo Berneri sont conservées dans les archives de l’Ovra, la police secrète fasciste ».
Un anarchisme « réaliste »
Dans des conditions d’une grande précarité (isolement, arrestations, problèmes de santé, journées de travail harassantes pour subvenir aux besoins de sa famille), Berneri est, malgré tout, parvenu à soutenir une activité intellectuelle foisonnante, qui s’est traduite par des interventions dans de nombreuses revues, sur des thèmes extrêmement variés, depuis les grandes questions classiques du mouvement ouvrier jusqu’à la psychanalyse ou la sexologie encore balbutiante.
Sa pensée apparaît sans cesse en évolution, échappant à tout dogme, quitte à ce que des divergences sérieuses se révèlent avec les opinions prévalant au sein de la mouvance libertaire. C’est là un point qu’il partage avec Rosselli, comme nous le confirme le philosophe Serge Audier en évoquant leur « propension à une révision infinie de la doctrine, suivant un procès continu d’autocorrection qui ne fétichise aucun cadre d’analyse ni solution ». Pour Giovanni Stiffoni, l’anarchisme de Berneri se veut « réaliste », car « lorsqu’il avance une proposition politique, [il] ne fait pas référence seulement à un système idéologique, mais il considère qu’une position politique peut être acceptable seulement s’il est possible de vérifier son efficacité dans la réalité ».
C’est cette approche qui l’a, par exemple, amené à se fâcher avec ses camarades à propos du principe de l’abstention aux élections. En 1936, il réagit positivement au fait que la CNT-FAI ait renoncé à sa traditionnelle propagande contre le vote, facilitant ainsi la victoire du Front populaire. Contre ceux qui ne comprennent pas cette décision, Berneri parle de « crétinisme abstentionniste » qui sévirait dans les rangs libertaires et trahirait un manque d’égard pour les effets pratiques d’un refus de participer aux procédures de vote. L’état des connaissances ne permettant pas, selon lui, de dégager une relation univoque entre une situation révolutionnaire et la participation ou non au jeu électoral, tout dépendrait de l’appréciation du contexte.
Il n’hésite pas, en revanche, à s’opposer à l’anticléricalisme professé par les anarchistes espagnols, le qualifiant de « borné et fou » (une appréciation anticipant les tueries dont religieuses et religieux furent victimes en zone républicaine, durant les premiers mois de la guerre civile). De manière générale, il déplore les projets visant à créer un régime de liberté inférieur pour les croyants et les agents du culte, et encore plus les agressions et les crimes à leur endroit : ceux-ci seraient non seulement indéfendables sur le plan moral, mais aussi contre-productifs en les repoussant dans les bras de la réaction. Ses mots sont durs : « L’anticléricalisme prend souvent le caractère de l’Inquisition rationaliste. Un anticléricalisme non libéral, quelle que soit sa coloration d’avant-garde, est fasciste. Non seulement fasciste, mais pas très intelligent. » D’après lui, les anarchistes risquent d’être les idiots utiles d’une gauche non révolutionnaire, agitant l’anticléricalisme pour éviter ou retarder le traitement de la question sociale. Or, insiste-t-il, « le prolétariat ne se nourrit pas de curés ».
Au sujet de ce dernier, Berneri se refusait au demeurant à toute mythification, s’agaçant de « l’idolâtrie de l’ouvrier » à laquelle auraient sacrifié de nombreux intellectuels libertaires, communistes et socialistes. Chez eux, ce réflexe aurait eu pour pendant une trop faible attention, voire un mépris injustifié pour la cause de la paysannerie (démographiquement importante dans le Sud italien, et en direction de laquelle il estime important d’avoir des propositions attractives). Le militant anarchiste constatait plus souvent qu’à son goût un repli de la classe ouvrière sur ses intérêts catégoriels, qu’il attribuait à l’absence d’une culture autonome suffisamment forte pour empêcher son imprégnation des valeurs petites-bourgeoises.
Il n’est pas jusqu’à sa conception de l’État qui n’ait été source de controverses. Certes, c’est sur ce terrain que sa critique du régime soviétique s’est particulièrement aiguisée. En 1936, il oppose ainsi « l’abolition de l’État » à la fausse « extinction » promise par la doctrine marxiste-léniniste. Critiquant les équivoques de cette dernière, Berneri alerte contre les dangers de la « dictature du prolétariat », dont il fait l’équivalent d’une formule jacobine propre à tous les détournements. Il constate, en tous les cas, que « ce n’est pas le prolétariat russe qui s’est emparé de la puissance de l’État, mais bien le parti bolchevique qui [a] créé un capitalisme d’État, une nouvelle classe bourgeoise, un ensemble d’intérêts liés à l’État bolchevique, qui tendent à se conserver en conservant cet État. […] Il faut être aveugle, estime-t-il, pour ne pas voir que le bonapartisme stalinien n’est que l’ombre horrible et vivante du système dictatorial léniniste ».
Pour autant, tout en avançant un projet d’une fédération à base communale pour l’Italie, composée de systèmes administratifs de taille modeste propices à l’implication populaire, Berneri évoque une « conception anarchiste de l’État ». Il apparaît, en effet, très soucieux de la nécessité d’une ossature organisationnelle permettant de coordonner des fonctions techniques et administratives indispensables à la vie collective. Il semble même assumer la persistance, au moins temporairement, d’élites compétentes et pourvues d’autorité pour assumer ces tâches. « Si l’Anarchie est la cité idéale, résume-t-il dans une formule, l’État libertaire est son approximation historique. »
Ces positions parfois iconoclastes, Berneri les devait à une formation originale puisée à des sources intellectuelles très diverses, depuis le libéralisme jusqu’au socialisme réformiste, en passant par le républicanisme. Il continua à s’y référer bien après son ralliement au mouvement libertaire, à la fois pour éprouver ses idées et par souci stratégique de construire des passerelles avec d’autres courants antifascistes. Autant Berneri pouvait engager des controverses intellectuelles sans concession avec ces derniers (ce sera le cas avec le mouvement Justice et Liberté de Rosselli, qu’il juge trop timoré sur la question de l’État), autant il n’hésitait pas à jouer le rôle d’aiguillon de ce qu’il appelait un « anarchisme à lunettes roses », trop peu attentif au caractère praticable de ses préconisations.
Revenons, pour finir, sur deux thèmes particuliers qui ont fait l’objet de publications récentes en français et illustrent la vitalité d’une pensée qui fait encore écho aujourd’hui.
L’« acteur » Mussolini et ses soutiens
Parce que « le fascisme contient la plus absolue et monstrueuse opposition historique et idéologique à [s]es idées de liberté politique et de justice sociale », Berneri a dévolu une bonne part de ses écrits à ausculter le phénomène. Un recueil, composé de textes rares en français, a été établi par Miguel Chueca et publié aux éditions Agone [4], en 2019.

On y trouve notamment son portrait de Mussolini en « grand acteur », sous-titré « psychologie d’un dictateur », resté comme l’un de ses essais les plus marquants. Il y décrit la propagande martelée au quotidien, dans les écoles, la presse et l’espace public, au service d’un homme qui se met en scène avec soin, dans des poses martiales et au cours de manifestations à sa gloire. Si Berneri reconnaît le talent de « meneur » et le « dynamisme théâtral » de Mussolini, il souligne la vacuité de sa pensée et le flou de sa doctrine, insistant sur le travail de son entourage, sans lequel il aurait été impuissant à bâtir son régime, prenant pour exemples le philosophe Giovanni Gentile ou le juriste Alfredo Rocco.
Les considérations sur la dualité du psychisme de Mussolini, et la façon dont il aurait compensé sa « faiblesse morale » par des postures violentes et pseudo-héroïques, ne sont pas inintéressantes mais davantage spéculatives, laissant en arrière-plan les ressorts qui ont fait du fascisme un mouvement de masse et un régime capable de forger un relatif consensus au bout d’une dizaine d’années. Plus stimulante, à cet égard, est l’inscription du personnage dans un type d’individualité qui a marqué l’histoire et la culture nationales : « Nous avons toujours eu des dictateurs, des démiurges ministériels, de grands agitateurs et des faiseurs de majorités parlementaires. […] Avant la guerre, il ne manquait pas en Italie d’idoles de la foule qui étaient des polichinelles, des aventuriers, de vulgaires opportunistes. Mais leur influence était bornée à une région, à une ville. »
Pour expliquer comment Mussolini a acquis une audience nationale au point de vouloir « se faire dédier des monuments, étant vivant », Berneri a fourni, dans d’autres textes, une genèse du fascisme qui permet d’identifier les épisodes et les groupes sociaux ayant facilité l’entreprise politique de l’ancien socialiste devenu dictateur. Il revient ainsi sur l’expédition du fantasque écrivain Gabriele D’Annunzio à Fiume, cette ville aujourd’hui croate revendiquée par l’Italie, envahie pendant quinze mois en 1919-1920 par une bande de légionnaires, dont beaucoup se retrouvèrent au service de Mussolini après la fin de l’aventure. Berneri souligne l’implication de hauts gradés militaires et les atermoiements de la classe politique italienne pour y répondre. « Dans la tour de Babel républicaine et militaire de Fiume était en germe toute la mystique du nationalisme fasciste », résume-t-il.
À propos de l’événement fondateur du régime – la marche sur Rome d’octobre 1922 –, il dénonce également la complicité passive ou active de la monarchie, de l’état-major et des milieux d’affaires envers les chemises noires qui allaient propulser Mussolini au pouvoir. Dans un autre texte s’interrogeant sur l’attraction du fascisme, il attaque violemment le manque de pédagogie et les erreurs tactiques des dirigeants de gauche. Selon lui, ces derniers ont excité la peur des classes moyennes sans avoir ou se donner les moyens d’une véritable révolution sociale et ont échoué à doter les masses laborieuses d’une culture propre à résister au fascisme. Délivrant une vision très sévère du bienno rosso, il estime qu’« il n’y [a] eu aucun sens héroïque dans la lutte des classes, mais une coalition mesquine d’intérêts sans la moindre lueur d’idéalisme. Il manquait enfin […] la confiance des masses à l’égard de leurs propres chefs, pour la plupart des avocats à la recherche d’une bonne place au Parlement ou des militants de profession accrochés à leurs prébendes ».
Au-delà de ces considérations propres à l’ascension du fascisme italien, Berneri se montre préoccupé par la puissance de la démagogie, dans des pages qui font écho avec les discours mensongers et grotesques, violents et spectaculaires tenus par des leaders autoritaires contemporains, qu’il s’agisse d’un Trump ou d’un Bolsonaro. Le militant anarchiste estime que « le vrai orateur, le grand orateur est celui qui fait de sa propre parole l’équivalent sensible de sa propre pensée ». Lu, le texte prononcé garde sa cohérence et son intérêt des années après. À l’inverse, « la faconde sans éloquence est le propre de l’orateur vulgaire. […] Une fois fini le discours-spectacle, il ne reste dans les cerveaux que quelque vague image fumeuse de tous ces feux d’artifice et tous ces moulins à vent ».
La dernière partie du recueil publié par Agone est consacrée à la guerre éthiopienne menée par Mussolini pour assouvir sa soif de prestige et faciliter l’union nationale, tout en donnant libre cours à une violence caractéristique de son régime (voir notre entretien avec Marie-Anne Matard-Bonucci [5] et lire notre recension du roman Tous, sauf moi [6]). Berneri a dénoncé la propagande du régime comme ses atrocités pour réduire le pays en esclavage. Un combat pour la vérité et contre l’impérialisme qu’il a partagé avec une autre des figures de cette série, la communiste dissidente Sylvia Pankhurst (lire l’épisode précédent [7]).
Une pensée pré-écologiste
Plus inattendu, Berneri a aussi été critique du productivisme et porteur d’une vision alternative de l’urbanité. Le philosophe Serge Audier, dans son dernier ouvrage, recensé par Mediapart [8], le présente comme l’un des rares protagonistes de l’entre-deux-guerres ayant maintenu « le fil ténu d’une tradition libertaire antiproductiviste qui ne connaîtra de véritable renaissance que durant les années 1960-1970 ».
Le culte du travail productif est d’ailleurs l’un des autres terrains sur lesquels Berneri s’est démarqué du régime soviétique. Dans un de ses textes, il fait ainsi allusion au mouvement stakhanoviste, qui, selon lui, est une façon absurde de transférer une logique de records sportifs dans la sphère de la satisfaction des besoins. S’il n’est pas hostile par principe à la rationalisation permise par des innovations techniques, elles doivent être mises au service de l’amélioration des conditions de travail en usine. À ses yeux, son compatriote communiste Gramsci était, par exemple, excessivement fasciné par l’industrialisme, ce qu’il imputait à l’impression subie par un intellectuel originaire d’une Sardaigne arriérée.
Mais la critique de Berneri envers l’idéologie des communistes de l’époque est aussi celle de leur conception des rapports entre villes et campagnes. Opérer un transfert de richesses entre les secondes et les premières, au moyen d’expropriations massives irréfléchies, conduirait, selon lui, tout droit à des désastres économiques. Au contraire, Berneri proposait des pistes permettant d’atteindre une plus grande harmonie entre ruralité et urbanité, tout en forgeant des cadres de vie propices à des liens politiques intenses au quotidien. L’exact inverse des tendances qu’il observait à son époque, à savoir la dégradation du milieu de vie et la raréfaction des espaces communs, ainsi que l’illustre sa description de la ville actuelle comme « un immense polype qui étend ses tentacules pleins de ventouses, suçant le sang, polluant l’air, profanant les âmes ».
Selon une approche hygiéniste, fondée sur la littérature scientifique du moment, Berneri préconisait davantage de proximité et d’accès aux éléments naturels, ainsi qu’une organisation urbaine permettant la circulation d’un air sain. Comme Audier le souligne, l’anarchiste italien n’était en rien partisan d’un retour en arrière, mais réfléchissait plutôt à incorporer les techniques de construction et d’aménagement les plus récentes dans un modèle de ville alternative, maîtrisé démocratiquement. « Plus proche, en un sens, de certaines tendances de l’époque du New Deal et de sa planification régionale, écrit le philosophe, Berneri n’était pas si éloigné des positions urbanistiques de Mumford [9], lui aussi héritier, à la même époque, de l’anarchisme de Reclus, de Geddes et de Kropotkine. »
Sans pouvoir être reprises telles quelles, ces intuitions pré-écologiques peuvent encore servir d’inspiration, à l’heure où il s’agit de repenser l’articulation entre les villes-centres et leurs périphéries [10] (afin d’éviter que les premières reportent sur les secondes les coûts cachés de l’amélioration du cadre de vie), et les interdépendances entre les métropoles et les territoires de faible densité [11].
Berneri, qui se voyait surtout comme un passeur de savoirs au sein de la mouvance libertaire, témoignait parfois de la frustration de ne pas pouvoir poursuivre un travail intellectuel aussi sophistiqué qu’il l’aurait souhaité. Plongé dans les drames du siècle, dont témoignent sa persécution par les fascistes et son assassinat par les staliniens, il n’a, de fait, pas créé d’école ni bénéficié d’une postérité à la hauteur de son originalité. Ses écrits n’en continuent pas moins à circuler et à être traduits, brisant lentement, malgré l’écoulement du temps qui sécrète aussi de l’oubli, l’isolement dont il a souffert en raison de son intransigeance et de l’intolérance des fossoyeurs de la liberté.
Fabien Escalona
Les années 1930 sont régulièrement convoquées dans le débat public. Que ce soit pour appréhender ou conjurer les menaces contemporaines, référence est souvent faite à cette décennie de désastres économiques, de confusion idéologique, de violences politiques et de montée aux extrêmes en matière internationale. Si une analogie point par point perd vite de son intérêt, cette période de « gros temps historique » fournit des échos qui peuvent se révéler utiles pour penser notre condition présente.
Dans cette perspective, nous avons souhaité mettre en valeur des trajectoires individuelles de « combattants de l’émancipation », qui n’ont rien lâché de leurs idéaux de liberté et d’égalité en dépit du caractère écrasant des forces adverses. Il ne s’agit pas de les ériger en modèles, même si leur courage, tout autant que leur fidélité à la construction d’un monde libéré de l’oppression et de l’exploitation, nous apparaissent édifiants. Cinq portraits de femmes et d’hommes de nationalités différentes composent cette série : ceux de Mika Etchebéhère (1902-1992), Carlo Rosselli (1899-1937), Sylvia Pankhurst (1882-1960), Paul Mattick (1904-1981) et Camillo Berneri (1899-1937).
En dehors de leur traversée d’une décennie au cœur de la grande « guerre civile européenne » du siècle dernier, leur unité réside dans un positionnement hérétique vis-à-vis des doctrines et organisations qui structuraient alors la gauche. Que ce soit au sein du socialisme, du communisme ou de l’anarchisme, toutes nos figures apparaissent comme des contestataires, des dissidents voire des marginaux. Parfois isolées, elles n’en ont pas moins cherché à favoriser des rassemblements pragmatiques contre les destructeurs du monde commun, loin de tout sectarisme ou hubris dominateur, dont elles ont plutôt été les victimes.
Leur rejet des dogmes ne découle pas seulement de la conviction que toute autorité, analyse ou stratégie doit être discutée. Ou plutôt, cette conviction est liée à un autre trait commun de ces personnalités : un engagement plein et entier au service d’une cause, jusqu’à mettre leur vie en jeu. L’intensité incroyable de leurs parcours tient à cette faculté de conjuguer une activité intellectuelle critique de l’ordre social et une activité militante de lutte pour une société alternative.
Œuvres et actes, théorie et pratique, se nourrissent les unes et les autres dans des proportions variables, à l’épreuve des tragédies qui saturent peu à peu l’époque. À cet égard, les traces laissées par ces figures méconnues de l’émancipation ne constituent pas seulement des témoignages d’un temps révolu. Si elles sont inspirantes, au-delà des parcours admirables dont elles sont le fruit, c’est parce qu’elles font encore réfléchir sur les combats d’aujourd’hui pour l’émancipation. Capitalisme, liberté, féminisme, urbanisme, justice globale… autant de réalités et d’enjeux avec lesquels nous devons encore composer, et qui peuplaient déjà l’univers des personnalités que nous avons choisi de mettre en avant.
 Europe Solidaire Sans Frontières
Europe Solidaire Sans Frontières


 Twitter
Twitter Facebook
Facebook